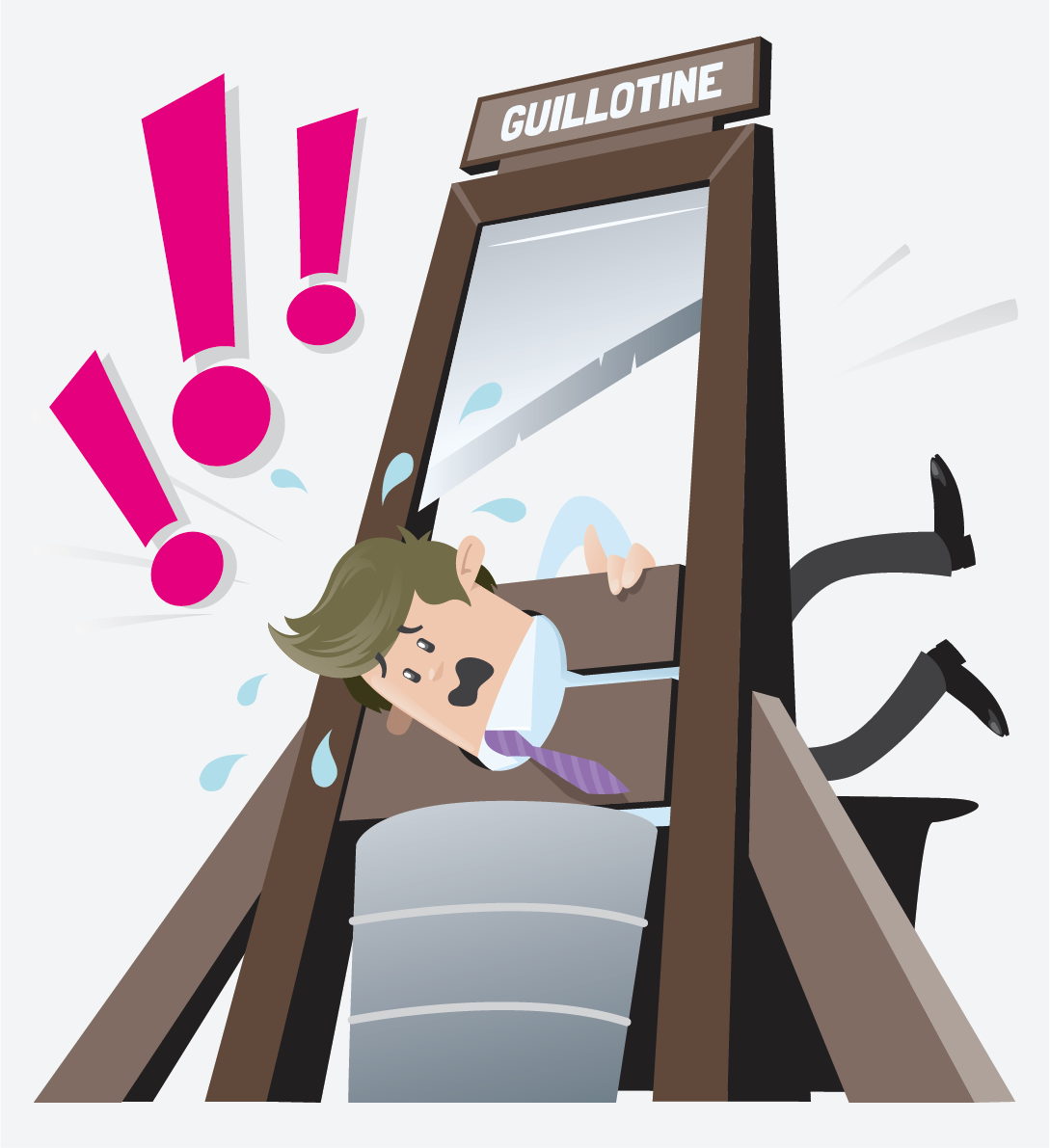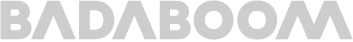Punir ou réinsérer?
«La pénalité moderne n’ose plus dire qu’elle punit des crimes; elle prétend réadapter des délinquants.» Ce constat, dressé en 1975 par le philosophe Michel Foucault (auteur du célèbre Surveiller et punir), n’a jamais été aussi à-propos. La question du rôle et du but de la peine carcérale est centrale dans la réflexion de celui qui désire gérer la criminalité. À en croire Michel Foucault:
«la punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus pénal. […] Il est laid d’être punissable, mais peu glorieux de punir. […] L’exécution de la peine tend à devenir un secteur autonome, dont un mécanisme administratif décharge la justice ; celle-ci s’affranchit de ce sourd malaise par un enfouissement bureaucratique de la peine. […] Et au-delà de ce partage des rôles s’opère la dénégation théorique: l’essentiel de la peine que nous autres, juges, nous infligeons, ne croyez pas qu’il consiste à punir; il cherche à corriger, redresser, “guérir”; une technique de l’amélioration refoule, dans la peine, la stricte expiation du mal, et libère les magistrats du vilain métier de châtier.»
En effet, le système pénal de notre société suit cette pente depuis de nombreuses années. La prison ne se présente plus en tant qu’organe chargé de punir; son but premier est devenu la réinsertion. Ce qui signifie que nous partons du principe que chaque individu – quelles que soient les atrocités qu’il a pu commettre – est récupérable et pourra, à terme, réintégrer la société.
Trop bon, trop con?
Voilà donc la conviction qui anime notre système carcéral: tout le monde est capable de réintégrer la société. Le principe est louable mais est-il seulement réaliste? Quand bien même nous serions conscients du caractère utopique d’une telle conviction, de cette foi aveugle en l’homme, ne faudrait-il pas tout de même encadrer la réinsertion de manière lucide et autoritaire afin de limiter les risques de récidive? Michel Foucault, encore lui, partait du principe qu’un criminel en phase de réinsertion devait accepter d’intégrer un système de surveillance. Mais peut-on véritablement parler de surveillance dans le processus de réinsertion que nous appliquons aujourd’hui? Où se trouve la surveillance lorsque le programme de réinsertion d’un violeur récidiviste prévoit des sorties équestres accompagnées d’une seule éducatrice. Une femme. Seule. Aux côtés d’un violeur récidiviste. Violeur à qui trois spécialistes ont accordé le droit de se procurer un couteau pour gratter les sabots de sa monture. Quand on sait que ce même violeur avait fait usage d’une arme blanche lors de ses précédents viols. On croit rêver.
De même, on se demande où se trouve la surveillance lorsqu’on apprend que les gardiens des centres sociothérapeutiques en milieu carcéral (comme celui de La Pâquerette) n’ont pas le droit de déplacer les affaires des prisonniers dans leur cellule. Motif de cette interdiction? Il faut respecter l’intimité des détenus. Où se trouve le bon sens ici? Et la prévoyance? La situation témoigne d’une telle naïveté qu’on serait tenté d’y voir une (très) mauvaise blague. Une blague dont la chute fait froid dans le dos. Nous pouvons désormais l’établir comme un fait avéré : la naïveté tue.
La faillite d’un système?
Le plus accablant dans l’histoire, c’est que chaque décision est prise par un comité de spécialistes. Aucun détenu ne se voit accorder une sortie éducative accompagnée sans l’accord de psychologues et de psychiatres. Quand on sait que Fabrice A. avait déclaré à ses codétenus qu’il voulait «buter» son ex-compagne qui vit actuellement en Pologne, on se demande sur la base de quelle expertise ces spécialistes ont jugé cet homme «apte à la sortie éducative accompagnée». Ne devrait-on pas parler, dans le cas présent, de faute professionnelle grave? Connaissez-vous d’autres professions où une erreur de jugement qui entraine la mort d’un innocent ne serait pas condamnée? Ce genre d’erreur ne témoigne-t-il pas de la faillite de notre système? Pourquoi n’exigeons-nous pas des comptes de la part de ces «professionnels de la réinsertion»? Car finalement, la «honte de punir» dont parle Michel Foucault et qui caractérise la politique de réinsertion de notre justice moderne, ne représente-elle pas un fond de commerce? Sur cette faille du système, «sur cette blessure, poursuit l’auteur de Surveiller et punir, le psychologue pullule.» Osons donc la question: dans l’histoire, qui y gagne? Et qui aurait à y perdre si nous remettions en cause ce système où, rappelons-le, la moindre erreur de jugement s’avère fatale?
Quand l’État nous condamne à mort
Le débat sur la peine de mort est mis sous scellé. La salubrité morale en a décidé ainsi. La discussion est close, le Bien l’a emporté, nous avons trouvé le Juste, le Vrai, nous n’exécutons plus car nous sommes civilisés. On met l’esprit en veilleuse; cette question là ne se pose plus. Au-delà du fait que les convictions les plus légitimes sont celles qui craignent le moins la remise en question et le débat public, nous pouvons nous demander si la libération de multirécidivistes ne débouche pas sur une autre forme de condamnation à mort. En relâchant des assassins, l’État ne condamne-t-il pas potentiellement à mort les citoyens qui croiseront leur chemin? Dans le cas où un meurtrier libéré venait à récidiver, l’État ne pourrait-il pas être accusé de complicité par angélisme? Quid du principe de précaution?
Question d’autorité
L’idéologie de mai 68 est tenace. C’est essentiellement à elle que nous devons le refus catégorique de toute forme d’autorité qui caractérise notre société. Ne parlons plus de «prisonniers» mais de «résidents». N’appliquons surtout pas des peines trop lourdes et érigeons la liberté en principe suprême. Il serait intéressant de savoir ce qu’en penserait Hannah Arendt, elle qui considérait que le problème le plus sérieux de toute politique moderne était «non pas comment réconcilier la liberté et l’égalité, mais bien l’égalité et l’autorité.» Pour résoudre ce problème, il faudrait dans un premier temps que nous arrêtions de confondre autorité et autoritarisme. L’autorité, au sens où l’entend Arendt, doit être différenciée de la contrainte par la force. Elle repose sur une hiérarchie dont la justesse et la légitimité sont reconnues par tous les participants. C’est une relation d’obéissance où les hommes conservent leur liberté. Selon ce principe d’autorité, la philosophe affirmait que nous devons exiger «qu’un être humain soit capable de distinguer le bien du mal même lorsqu’il n’a pour le guider, que son propre jugement, et que ce jugement se trouve être en contradiction avec ce qu’il doit tenir pour l’opinion unanime de son entourage.» En d’autres termes, se soucier de l’autorité revient à se soucier de la stabilité de nos sociétés.
«La politique n’est pas une nurserie» disait-elle encore. Aujourd’hui, nos prisons portent des noms de fleurs.